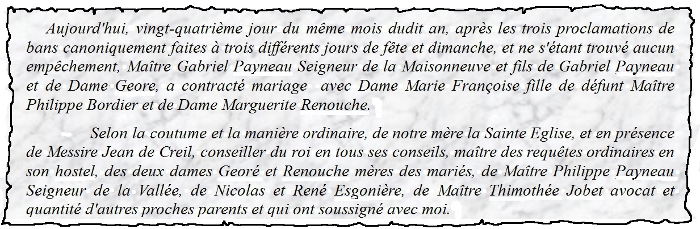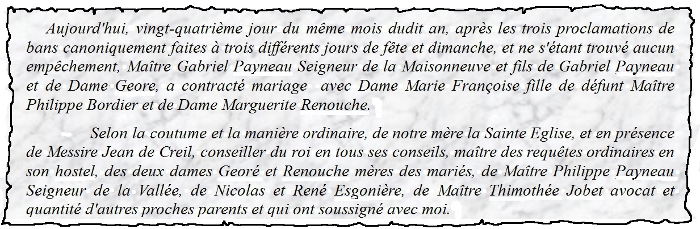Jean de Creil, marquis de Bournezeau
Nous sommes le 24 Septembre 1680. C'est jour de fête à Bournezeau. Les
familles Payneau et Bordier vont unir deux des leurs.
Notre bon curé Avril est à la manœuvre. Il célèbre sans doute le
mariage de l'année et rédige l'acte suivant:
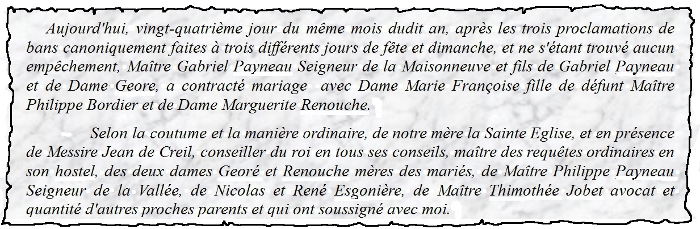
En cette fin de XVIIe siècle les témoins d'une noce sont
soigneusement choisis. Ils montrent à la communauté l'appartenance des
époux à un milieu social. Ce mariage de notables donne sans doute avec
l'ordre d'apparition des signataires, une excellente photographie de la
pyramide sociale de la bourgeoisie catholique de la fin du XVIIe.
La position de chacun est ainsi mise en évidence.
Or, fait rarissime, le curé Avril cite un invité avant les
parents des mariés. La présence de Jean de Creil devient
l'élément majeur de la cérémonie. Le seigneur de Bournezeau, cet homme que
l'on voit rarement sur ses terres, celui qui grâce à son poste peut
côtoyer le Roi Soleil, assiste à la cérémonie. Nul doute que cet événement
peut être ressenti comme un honneur par les familles des époux.
Les de C reil ne sont cités que deux fois dans les registres
paroissiaux de Bournezeau. Jean de Creil sera l'année suivante le
parrain du premier enfant du couple Payneau-Bordier.
De cette présence exceptionnelle naissent d’autres questions. Tout le
monde se doit d’être à la noce. Alors, où sont les Béjarry, les Piniot
de la Girardière, les Raffou ? Ces familles protestantes,
ou récemment converties, sont absentes. Il est néanmoins possible, comme
cela se fait beaucoup à l’époque, qu’elles attendent à la porte de
l’église. Mais en ce jour précis, si tel est le cas, il s’agit d’une
erreur. Le roi, est au sommet de sa puissance. Sa volonté ne souffre
aucune contestation. Elle tient en une devise : Un roi, une foi, une
loi. Pour atteindre ce but il a besoin d'hommes de valeur. Jean de Creil,
lui, est l'un de ceux qui ont mis en œuvre la volonté royale dans ses
succès, comme dans ses injustices.
Le rapprochement avec l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais le maître
des requêtes ne l'entend pas ainsi. Il a besoin d'un nom à hauteur de ses
ambitions. Ilchoisit celui de de Creil-Bournezeau, entraînant
avec lui le nom de notre commune dans les livres d'histoire. Quels sont
les rapports de nos ancêtres avec les de Creil ? Que savons-nous
aujourd’hui des deux hommes et des deux femmes qui ont porté le nom de Creil-Bournezeau
? Pourquoi pendant un siècle le nom de notre commune était-il “Creil-Bournezeau”
? Le challenge étant lancé, la commission histoire se devait de relever le
défi et de lever le voile de l’oubli.
Les recherches sur la famille de Creil conduisent rapidement à
une historiette qui trouve son origine au Poiré-sur-Velluire.

Le château du Poiré-sur-Velluire
René du Chastelier-Barlot, petit-fils de Léon, l'auteur desMémoires
pour servir à l'histoire, depuis l’an 1596 jusqu'en 1636” —
>Fontenay-le-Comte, Pierre Petit-Jean, 1643, pet. in-4° de
113 pages, et dernier descendant mâle de cette famille, ne mourut
point seigneur du Châtelier, s'il faut en croire la tradition. En juillet
1630, cette terre fut vendue à Paris, par décret de justice, à la requête
de Jean de Creil, marquis de Creil-Bournezeau, conseiller du
roi, intendant de la généralité d'Orléans, qui s'en rendit adjudicataire.
Ce dernier, fils ou petit-fils d'un maçon de Bournezeau, ayant offert au
marquis ruiné de lui donner sa fille en mariage, il lui répondit, en vrai
baron allemand, qu'il préférait mourir pauvre que de se mésallier. Avant
la révolution de 1789, des vieillards du Poiré-de-Velluire montraient, en
effet, une espèce de toit à porcs, où ils avaient entendu dire par leurs
grands-pères que leur ancien seigneur était mort dans la détresse, après
avoir mangé tout son bien. La fille de Creil mourut, au
contraire, duchesse de Beauvilliers-Saint-Aignan(Note de Mercier
du Rocher).
Les de Creil dans le Bas-Poitou apparaissent comme des nobles
parvenus, des malfamés qui se servent de leur ascension sociale récente
pour dépouiller la noblesse locale. Néanmoins, on note quand même une
certaine admiration : un fils d’un maçon de Bournezeau a réussi à marier
sa fille avec un duc, et pas n’importe lequel : un de Beauvilliers de
Saint-Aignan, un des proches du roi.
Une lettre de Mme de Sévigné du 30 Octobre 1656, nous donne la
perception parisienne de la famille de Creil. Le récit surprenant
est celui d'une cavalcade costumée. Partie du quartier Saint-Paul, haut
lieu du Marais parisien, la troupe de cavaliers passe par Nantes puis
aller jusqu’aux aux Sables-d’Olonne ! (Nous notons au passage que les
Sables dès le 17e sont déjà un lieu de villégiature pour
parisiens fortunés). La troupe s’arrête à la Meilleraye, sur les
terres du Maréchal. Celui-ci dirige alors l’Arsenal qui est justement à
deux pas de la rue Saint-Paul. A la tête de la chevauchée, un ambassadeur
et une femme “La divine de Creil>”. Aux yeux de
l’épistolière, la famille de Creil frôle l'excellence.
Ces deux versions sont aux antipodes. Qui devons-nous croire :
l'épistolière ou nos historiettes du coin du feu ? Il faut continuer à
chercher. Mais nous verrons dans la suite de cet article, que ces deux
versions nous ont mis sur les bonnes voies.
La vie parisienne des “de Creil”

|
Le blason
et le dessin de la pierre tombale
de la chapelle St Henri
|
 |
Trois documents nous permettent de toucher du doigt la vie parisienne des
de Creil : un acte notarié du Duc de la Force, une
pierre tombale aujourd’hui détruite, et un blason.
Leur blason est constitué d'un chevron d'or accompagné de trois clous de
la passion, le tout sur une couleur azur. Il nous indique que les “de
Creil” sont des personnes pieuses (les clous de la passion
représentent la souffrance du Christ) et éprises de justice (la
constance et la fermeté du chevron).
C’est une famille de magistrats. Et à Paris, le haut lieu de la
magistrature est le Châtelet. Nous sommes encore tout près du quartier du
Marais.
En cette fin du 17e, Paris se couvre d’églises. Leur
financement est assuré par la nouvelle bourgeoisie soucieuse de
reconnaissance.
Les de Creil participent à ce mouvement. Ils contribuent à la
construction d’une chapelle destinée à recevoir le caveau familial. C’est
dans l’ancien couvent des Grandes Carmes de la place Maubert qu’Henry de
Creil, le père de Jean, a décidé que la famille reposerait. A deux
pas de Notre Dame, en plein centre de Paris, le choix semble judicieux
pour passer à la prospérité. C'est en fait une erreur : l’église des
Carmes n’a pas survécu à la révolution. Mais le caveau familial et les
inscriptions qu’il portait ont été dessinés faisant passer ainsi l’arbre
généalogique des de Creil à la postérité.
C’est enfin un acte notarié du Duc de la Force qui nous confirme
l’adresse de Jean de Creil : Le 10 rue des Lions-St-Paul, un
hôtel particulier dont le jardin donne sur le quai des Célestins, face à
la Seine et à son port.

Le couvent des Grandes Carmes place Maubert
Comme indiqué par Mme de Sévigné, les de Creil ont élu
domicile à l’ombre de l’arsenal du maréchal de la Meilleraye. La
carte ci-dessous, même si elle est du début du 18e, remplace
tous les mots pour décrire l’atmosphère, le paysage urbain dans lequel
évoluait Jean de Creil.

1- La cathédrale Notre Dame sur l’île de la Cité.
2- La rue des Lions où a vécu la famille de Creil.
3- Le grand Arsenal du duc de la Meilleraye.
4- Le couvent des grandes Carmes où se trouvait le caveau de la famille de
Creil.
Jean de Creil et Bournezeau : Les raisons d’une union
Lorsqu'en 1680 Jean de Creil vient à Bournezeau, il lui manque
pour réussir son ascension sociale trois choses : un titre de noblesse
pour devenir un parti acceptable, une épouse pour lui ouvrir les portes
des alliances politiques à la hauteur de ses ambitions, et une fonction
que seul le roi peut lui donner.
L’homme est à la fois efficace et pressé. Quand il perd sa femme, Jeanne
Masson, il n’est pas abattu. Volontaire, il rebondit
immédiatement. Il ne lui faut que trois ans pour atteindre tous ses
objectifs. Alors que le roi a besoin d’argent, Jean est prêt à acheter un
titre de marquis. Le roi souhaite enraciner un catholique sur ces terres
du bas Poitou pour en repousser les protestants et s’assurer que les
récentes conversions s’affermissent. La famille de Creil a fait
preuve de sa foi. Jean, avec son expérience de maître des requêtes, est
préparé aux travaux politiques sensibles. Il appartient à ce milieu de
bourgeois éduqués, travailleurs, qui sont les dignes émules d’un Colbert
et qui plaisent au roi. Il devient rapidement un allié capable de
contrôler les agissements de la grande noblesse du Bas-Poitou. Désormais
le duc de la Trémoille fils de la très fervente protestante Marie
d’Auvergne, même sur ses terres du duché de Thouars, doit laisser
de côté ses anciennes alliances protestantes.
Jean de Creil de Bournezeau obtient du roi, par lettre patente,
l’érection de Bournezeau au rang de marquisat, et la commutation du nom de
Bournezeau en celui de Creil. Une seule condition: Bournezeau doit
désormais rester catholique.
Avec le titre de Marquis, Jean de Creil est devenu un parti tout
à fait convenable. C’est un autre maître des requêtes, Jérome d’Argouges,
qui lui ouvre les portes du pouvoir. La famille d’Argouges
appartient à l’histoire et aux mythes Bretons. Attachée depuis longtemps à
la maison des reines de France, Anne d’Autriche, la mère de Louis
XIV a permis à François d’Argouges, le père de Jérome, de devenir
président du parlement de Bretagne et d’ accéder ensuite au conseil royal
des finances. François d'Argouges, en acceptant de donner la main
de sa fille Suzanne à Jean de Creil, sait qu’il réalise une
alliance de choix. Les intérêts de la Bretagne et du Bas-Poitou sont
désormais réunis et portent un nom : de Creil-Bournezeau. Le
mariage est certainement célébré par un autre François d’Argouges:
Fils du précédent, il est l’évêque de Vannes et devient désormais
beau-frère de Jean.
C’est maintenant au roi d'agir. Le poste d’intendant des provinces (l'équivalent
de nos jours d’un super préfet, à la tête de trois voire de quatre
départements) est envié par tous les maîtres des requêtes. Le 23 mai
1686, le roi, fidèle à sa conduite, choisit de nommer Jean de
Creil-Bournezeau à Moulins. Le représentant de la noblesse de robe
est élu avant son beau-frère, le descendant de la noblesse d’épée.
Jean de Creil sait néanmoins renvoyer l’ascenseur. Car deux ans
plus tard, lorsqu’il est nommé à Orléans, c’est Jérôme d’Argouges
qui lui succède à Moulins avant d’être lui-même appelé en Bourgogne. La
parentèle d’A rgouges est en place. Le bas-Poitou, la Bretagne,
le Centre, l’île de France, la Bourgogne, l’Auvergne sont autant de terres
où la famille a des représentants.
Jean de Creil de Bournezeau,
un catholique, au service du pouvoir absolu
Une ascension aussi rapide peut détruire un homme, le détourner de son
esprit critique. Parce que le roi veut, Jean de Creil-Bournezeau,
son intendant, doit exécuter. Ayant été nommé pour mettre en œuvre la
conversion des partisans de la religion prétendue réformée (les
protestants), il va devenir rapidement, au même titre qu’un Bossuet,
l'un des principaux artisans de cette abominable erreur historique.
Aubusson, pour ne citer que cet exemple, garde le triste souvenir de la
fermeté de l'intendant “de Creil-Bournezeau”. La ville est
convertie, mais au prix du départ de la majorité des maîtres tapissiers.
Durant cette période sombre pour le nom de Bournezeau, l’intendant met en
œuvre tous les moyens répressifs possibles : l’emprisonnement, la
séparation des enfants avec leur famille, les dragonnades et les abus
qu’elles engendrent, l'achat des conversions. L’historiette des anciens du
Poiré-sur-Velluire n’est donc pas infondée. Elle repose sur un fait.
L’ouest a connu sous Louis XIII deux grands chefs militaires: Henry de
la Trémoille et Léon du Chastelier-Barlot. Ces deux
protestants ont été capables de lever 4 000 hommes pour aller combattre en
Italie. La menace était sans doute prise au sérieux à Paris. Mais le
descendant des Chastelier-Barlot n’a pas la même envergure que
son grand-père. Jean de Creil de Bournezeau va se charger de
racheter ses terres éloignant un peu plus la possibilité d’une révolte
protestante en Bas-Poitou.
Si l’histoire s’arrêtait là, la famille de Creil qui a associé
le nom de Bournezeau à la traque des protestants ne justifierait même pas
que l'on lise ces quelques lignes. Mais l’intendant sait tenir compte des
erreurs. Le roi veut le bonheur de ses sujets. Il fait en sorte d’y
contribuer.
Jean de Creil le réformateur
L’intendant a été nommé pour faire prospérer sa province. La prospérité
se mesure à l’impôt payé. Encore faut-il que la collecte soit efficace. La
corruption et la fraude sont généralisées. Jean de Creil va s’y
attaquer en trois temps.
La collecte de l’impôt coûte parfois plus qu’elle ne rapporte !
L’intendant va imposer ses méthodes aux collecteurs, et les résultats vont
être rapidement visibles.
Le 26 Juin 1688, Jean de Creil-Bournezeau écrit :
« Les receveurs d'icy commencent à apprendre leur métier, et à force
de leur avoir fait réprimandes et des leçons, ils ont du moins compris
que leur principale application doit estre à retrancher les frais de
recouvrement. Le tarif que j'ay fait, et qui s'y observe exactement, n'y
contribue pas peu, et je ne doute point que l'année prochaine ils ne
soient encore moindres. […] La recette de l'année dernière est acquittée
il y a près d'un mois, et les frais de tout ce recouvrement ne montent
pas à 600 lt [livres tournoi]; La recette de cette année
approche fort de la moitié de l'imposition, et les frais jusqu'à
aujourd'hui ne passent guère 300 lt. »
Les intermédiaires dans la collecte de l'impôt peuvent être nombreux et
parfois sans aucune légitimité. Jean de Creil-Bournezeau,
observe, note, et si le roi le veut, revient sur des pratiques douteuses.
« … ce tribunal des chasses s'accroît et se multiplie par toute la
France, à la foule du public, et il est des endroits où l'exercice en a
plus cousté que la taille mesme. Les gardes qui font leur rapport n'ont
d'autres salaires qu'une part qu'on leur donne dans les amendes, et,
comme il en est peu qui ayent serment de justice, et que beaucoup mesmes
des juges n'ont ni provisions ni caractères, la passion et l'avidité des
uns et des autres sert de règles et de loy aux rapports et aux
jugements, et, dans la vue que Sa Majesté a de soulager ses peuples,
j'ose vous dire qu'il n'est plus de moyens plus assuré pour le faire
qu'en retranchant de ces tribunaux et en diminuant leur autorité. »
Mais le plus important est que la fraude fiscale se pratique à grande
échelle. Le 17e a des airs d’époque moderne. Le sport national
est d'éviter à ceux qui en ont les moyens de payer des impôts. Jean de
Creil-Bournezeau s'attaque à de puissants nobles. L'intendant ne
doit pas mécontenter les amis du roi, les protégés des Princes. Jean de
Creil-Bournezeau va appliquer une démarche que notre ancien
ministre Éric Woerth a utilisé récemment avec les comptes en
Suisse. Il se rend à Vendôme et écrit au Contrôleur Général.
« Cette année, je n’ai fait qu’observer. J’ai maintenant en ma
possession une liste de noms bénéficiant d’exemptions qui me semblent
sans fondement. Si le roi le souhaite il en sera ainsi. Sinon je donne
un an aux abus pour cesser. »
Cette lettre qui a traversé l’histoire a dû provoquer un sérieux émoi.
Mais l’histoire retient que Jean de Creil-Bournezeau a été le
réformateur fiscal de la ville de Vendôme.
Jean de Creil le bâtisseur
Jean de Creil-Bournezeau est un infatigable voyageur. Les
intendants sont les yeux du pouvoir. Le roi veut savoir comment se porte
son agriculture. Il observe l’évolution des fermes et des récoltes. Mais
pour que le commerce se développe, les routes doivent être en bon état. Là
encore, Jean de Creil agit en venant au secours des villes comme
Montargis qui en ont le plus besoin. Son sens de la responsabilité et son
investissement personnel dans l’action et le suivi est souvent
remarquable.
Le 14 Juin 1686 Jean de Creil-Bournezeau écrit au contrôleur
général:
«J'ay visité la grande chaussée qui s'entretient au dépend du Roy
depuis Etampes jusqu'à Artenay, et je l'ay trouvée en plus mauvais estat
que je ne l'aye vue depuis un grand nombre d'années que je passe par ce
chemin; Je tiendrai la main aux ouvriers le plus près que je le pourray
et ne manqueray pas de vous rendre compte et prendre ordre sur tout».
Un ouvrage hors du commun attend Jean De Creil-Bournezeau. La
Bretagne et le Bas-Poitou ont besoin que les marchandises arrivent plus
vite sur les quais parisiens. Les bateaux peuvent remonter la Loire
jusqu’à Orléans en étant poussés par le vent d'Ouest (le vent de
Galerne). Mais pour la suite du voyage, seul le halage permet de
s’éloigner de Paris jusqu’à Briare pour y rejoindre le canal. Cela a un
coût élevé. Creuser un canal entre Orléans et Montargis serait la
solution. Plusieurs hommes ont essayé. Ces tentatives ne furent que des
échecs.

Cartes comparatives du transport de marchandises vers la capitale à la fin
du règne de Louis XIV (navigation à voile sur la Loire puis les canaux) -
Travail personnel d’après Roger Dion "A propos du canal de
Briare", 1937. http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_d'Orléans
Le frère du roi (le prince d’Orléans), puis le roi lui-même ont
participé aux investissements. Mais de nouveau le canal n’avance plus.
L'ouvrage est confié le 4 Mai 1687 à Jean de Creil-Bournezeau.
Il négocie les expropriations nécessaires, règle avec les ingénieurs de
l’époque, les problèmes d’alimentation en eau, fait appel à la
milice pour faire avancer les travaux en hiver lorsque cela est
nécessaire. Le canal est officiellement réceptionné le 31 Décembre 1691.
Il est ouvert à la circulation le 5 mars 1692. Le succès est immédiatement
au rendez-vous: 2 300 bateaux empruntent cette nouvelle voie navigable dès
la première année et rapportent 220 000 Livres. L’alliance entre la
Bretagne et le Bas-Poitou conçue par François d’Argouges porte
ses fruits. L’ouest avec le canal d'Orléans remporte une victoire sur la
Bourgogne et le canal de Briare.

Haleurs sur le canal d’Orléans
Jean de Creil de Bournezeau
l’économiste à l’écoute de ses administrés
Les succès de Jean de Creil-Bournezeau auraient dû lui valoir
des périodes d’accalmies. Mais deux éléments échappent à son contrôle: le
climat et la volonté royale. 1693 et 1694 ont été deux années aux hivers
rudes accompagnées d'une grande sécheresse. Louis XIV est en guerre.
L’anglo-Néerlandais Guillaume III d'Orange Nassau, devenu le
champion des protestants, a su allier toute l’Europe contre le Roi Soleil,
au travers la Ligue d’Augsbourg. De 1688 à 1697, le royaume vit au rythme
des batailles et des déplacements de troupes. L’intendant fait de son
mieux. Mais il doit évoluer. Le serviteur zélé se démarque petit à petit
de son souverain. Il a une vision des plus précises des flux monétaires.
Et c’est avec une grande lucidité, lorsque sa province souffre trop, qu’il
se permet de mettre le grand roi en face de ses responsabilités :
« Le Roy le veut, c'est assez pour qu'on tire tout ce qu'il y a
d'argent dans la province; mais si l'on ne trouve pas le moyen d'y en
faire revenir et que la circulation cesse, comme elle commence, il ne
restera plus qu'une bonne volonté et une impuissance parfaite dans des
sujets plus dévoués encore à leur prince par inclination que par devoir»
Le 11 février 1691, il signale dans la Beauce plus de cent fermes
abandonnées. Il rapporte le 15 Novembre de la même année de Châteaudun:
« La misère est si grande partout et tant de fermes sont désertes que
j'ay eu une peine extrême à faire l'imposition pour cette élection. »
Les soldats ne cessent de passer. Jean de Creil doit les nourrir
et rembourser ceux qui ont été réquisitionnés. Puis les sergents
recruteurs enrôlent de force, ce qui diminue la main d'œuvre pour les
récoltes à venir. L'hiver, les soldats prennent leurs quartiers. Et c'est
alors 89 compagnies que Jean de Creil-Bournezeau doit
entretenir, alors que les ressources de la province sont au plus bas.
Les paysans se cachent et n'osent plus venir en ville. Jean de
Creil-Bournezeau s'oppose alors aux prélèvements de blé, puis au
recrutement par l'armée. Pour lutter contre la famine, il propose et
obtient la suppression d’une taxe sur les blés en 1693. L'exercice du
pouvoir en a fait, difficulté après difficulté, un homme d'état au sens
noble du terme, car au service d'une province.
La chute de la parentèle

Louis XIV et son conseil
Une nouvelle tombe en 1694 : Jérôme d'Argouges, le beau-frère du
marquis Jean de Creil-Bournezeau est suspecté en Bourgogne
d'enrichissement personnel. Il s'en défend. Mais le roi tranche. La
parentèle d'Argouges doit être écartée pour un temps du pouvoir.
Les deux intendants sont déchus en même temps. Mais pour Jean, le fidèle
serviteur, ce n'est pas une mise à la retraite. Le roi estime que son zèle
constant depuis plusieurs années et que ses efforts pour remédier aux
calamités méritent récompense. Il siège désormais au conseil d'état, poste
qu'il occupe jusqu'à sa mort en 1709.
La famille de Creil est issue de la petite Bourgeoisie. Jean de
Creil a associé le nom de Bournezeau à une ascension politique
exceptionnelle. Il ouvre la voie à son fils Jean-François qui sera
intendant à Metz, et aussi à sa petite-fille la future duchesse de
Beauvilliers-Saint-Aignan. Mais ce sont là deux autres histoires
que les Bournevaisiens devront aussi sortir de l'oubli.
Jean-Luc Bonnin
à mon oncle Raphaël qui nous a quittés en décembre
et à tous les Remaud qui en mélangeant leur sueur à la terre de Bournezeau
nous ont permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui.
Sources :
État du Poitou Sous Louis XIV page 241
Lettres de Mme de Sévigné, de sa famille et de ses amis
recueillies et annotées Par M. Monmerqué (Publication L.
Hachette)
- Antiquités Nationales ou recueil des monuments, pour servir l'histoire
générale et particulière de l'empire François, tel que Tombeaux,
Inscriptions, statues, … Par Aubin Louis Millin Tome quatrième
(Carmes de la place Maubert P 321)
-
http://doc.geneanet.org/registres/zoom.php?idcollection=3741&page=82&r=1&Larg=1280&Haut=800
- Plan turgot 1736 :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Plan_de_Turgot.jpg
- Archives Nationales : X1A-876 Érection des terres et des seigneuries de
Bournezeau, des Pineaux et de Puymaufrais, et leurs dépendances en titre
nom et dignité de Marquisat et commutation de nom de Bournezeau en celui
de Creil pour en jouir par le Seigneur de Creil
- Histoire physique, civile et morale de Paris, par J.A. Dulaure de la
société des antiquaires d France (Note sur l'obtention de la charge de
Président du parlement de Bretagne – mémoires de Monglat t IV, p
253 et suivantes)
- Journal du Marquis de Dangeau (18 Août 1684) Vendredi 18
Monseigneur alla tirer dans la plaine de Montrouge, et partit à cinq
heures du matin; Il revint à la messe du roi.- L'après dinée, le roi alla
tirer dans son parc, et Monseigneur le suivit. - M. de Vertamon
n'accepta pas l'intendance de Bourbonnois, et on la donna à M de
Creil, gendre de M d'Argouges.
- Journal du Marquis de Dangeau (23 Mai 1686)
- Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants
des provinces publiées par ordre du ministre des finances, d'après les
documents conservés aux archives nationales par A.M.de Boislisle
: p. 58, p. 155, P.219, p. 284, p.243, p.343, p.347
- Nombreuses lettres dans la série O1-30 des archives nationales
- L'administration des intendants d'Orléans de 1868 à 1713 Charles de
Beaucorps p.29, p.31, p.33, p.36
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_d'Orléans
-
http://www.alertes-meteo.com/catastrophe/annees-de-misere-age-glaciaire.htm
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_la_Ligue_d'Augsbourg
- Sara E.Chapman, Private Ambition and Political Alliances. The Phélipeaux
de Ponchartrain Family and Louis XIV's Government, Family and Louis XIV's
Government, 1650-1715 p.85