« Aujourd’hui dimanche 17ème du mois de février 1704 en l’assemblée des manants et habitants de la paroisse de Saint-Vincent-Fort-du-Lay convoquée par et à la diligence de Maître Louis V
Les plus anciens actes rédigés par les notaires de Bournezeau
remontent à 1692. Leur étude nous révèle l’existence d’une institution
politique au sein de la paroisse dans la première moitié du XVIIIème
siècle. Cette institution qui existait depuis au moins le XVIème
siècle, était l’assemblée des habitants et constituait l’unité de base de
la vie administrative locale sous l’Ancien Régime. Elle était chargée du
temporel de l’Église dont elle choisissait le fabriqueur et de la vie
politique de la communauté villageoise dont elle désignait les collecteurs
et les syndics.
Le rôle du notaire était de retranscrire un compte-rendu pour
donner une valeur officielle aux décisions prises par l’assemblée. Cette
dernière pouvait se réunir plusieurs fois dans l'année.
Bien que très lacunaire, le temps a préservé 25 actes notariés
retrouvés dans les minutes de deux notaires de Bournezeau : Jean L
Voici 2 extraits d’actes rédigés par le notaire Jean L
« Aujourd’hui dimanche 11ème du mois de septembre 1701 en l’assemblée des manants et habitants de la paroisse de Creil-Bournezeau étant sous les halles dudit lieu à l’issue des Vêpres au son de la cloche en la manière accoutumée, icelle assemblée convoquée par Maître Gabriel Payneau , procureur-syndic de la dite paroisse (…) »
« Aujourd’hui dimanche 17ème du mois de février 1704 en l’assemblée des manants et habitants de la paroisse de Saint-Vincent-Fort-du-Lay convoquée par et à la diligence de Maître Louis Vrignonneau syndic perpétuel de ladite paroisse,étant au-devant de la grande porte et entrée principale de l’église paroissiale dudit Saint-Vincent hors lieu saint à l’issue de la grande messe paroissiale au son de la cloche en la manière accoutumée(… ) »
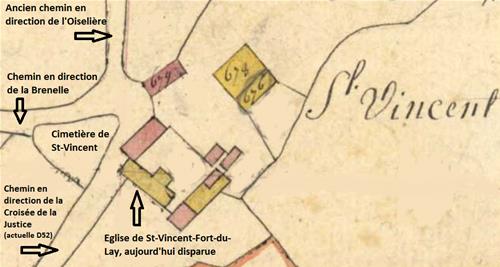
Une ordonnance de 1559 interdisait les réunions dans des lieux
privés comme chez les particuliers ou dans les cabarets. Elles ne
pouvaient pas non plus avoir lieu dans un lieu consacré comme l'église.
Les mairies n'existant pas à cette époque, les habitants de Bournezeau se
réunissaient sous les halles et ceux de Saint-Vincent devant la porte
principale de l'église. À Thorigny, les habitants se réunissaient dans le
cimetière qui jouxtait l'église.
La grande messe dominicale rassemblait l'ensemble des paroissiens,
d'où l'opportunité de placer les assemblées juste à la sortie de la messe,
au son de la cloche. Elles étaient convoquées plusieurs jours auparavant à
l'initiative des habitants, du fabriqueur, du curé, des collecteurs ou, le
plus souvent, du syndic. Le motif de l'assemblée devait être précisé. Le
curé, lors des messes précédentes, en informait les paroissiens.
Étaient convoqués « les manants et habitants de la
paroisse ».
Dans certains actes, était mentionnée l'expression suivante : « faisant et composant la plus grande et saine partie des habitants ».
Il s'en suivait la liste de plusieurs paroissiens qui savaient signer et
qui payaient la taille, le plus important des impôts directs sous l'Ancien
Régime. Une grande majorité des participants étaient des bourgeois, des
fermiers, des laboureurs... Il est néanmoins impossible de donner le
nombre d'habitants réunis car ils n'étaient pas tous nommés.
Le seigneur des lieux pouvait y assister. Dans aucun des 25 actes
retrouvés, il n'est fait mention de la présence du seigneur du marquisat
de Bournezeau,
Pareillement on ne retrouve aucune femme mentionnée à Bournezeau ou
à Saint-Vincent. Cependant elles pouvaient délibérer si elles étaient
chefs de famille, autrement dit veuves, et imposables.
1) Le syndic
C'était l'une des personnes les plus importantes de la paroisse. Il
représentait la communauté villageoise et son pouvoir dépendait de la
volonté des habitants qui le choisissaient lors d'une assemblée. Le syndic
s'occupait des affaires publiques de la paroisse et était souvent à
l'initiative des convocations des assemblées pour délibérer de ces sujets.
Sa charge était prenante même si nous ignorons, faute de documents,
son rôle précis dans nos deux paroisses. De ce fait, il n'était pas soumis
à la collecte, ni à la corvée (impôt direct). Son mandat ne devait pas
excéder 3 ans. Il devait évidemment savoir lire et écrire.
Pour Bournezeau, 4 actes sur 14 concernaient la nomination d'un
nouveau syndic :
- Le 14 juin 1722, Jean-Nicolas P
- Le 8 décembre 1723, VincentP
- Le 7 octobre 1725, André G
- Le 8 septembre 1727, André B
À Saint-Vincent-Fort-du-Lay également, 4 actes concernant le choix
du syndic sont parvenus jusqu'à nous :
- Le 25 septembre 1717, l'assemblée nommait Jacques B
- Le 22 octobre 1719, Jacques V
- Le 18 avril 1723, René R
- Le 3 mars 1743, Pierre M
2) Le fabriqueur
À l'instar du syndic, le fabriqueur était nommé par la communauté
des habitants. Le curé devait probablement avoir un droit de regard
puisqu'ils étaient amenés à travailler ensemble. Toutefois le dernier mot
revenait aux habitants. Ainsi en juin 1761, dans la paroisse de la
Couture, le syndic et le curé s'étaient opposés à une candidature au poste
de fabriqueur. Ce candidat fut pourtant élu à l'unanimité par les
habitants.
Le fabriqueur était chargé de la gestion de la fabrique et des
biens temporels de l'église. Il était dépositaire de tous les titres et
papiers de ladite fabrique comme les livres, les ornements, des reliques.
Il devait savoir lire et écrire. En contrepartie, il était déchargé de la
corvée et de toute charge publique : Il ne pouvait pas être choisi
comme collecteur de l'impôt par exemple.
Nous n'avons en notre possession qu'un seul acte de nomination d'un
fabriqueur. À l'initiative du syndic de Saint-Vincent-Fort-du-Lay, Louis V
« Ledit V
3) Les collecteurs
Les habitants, réunis par le syndic en assemblée et obligatoirement
en sa présence, devaient nommer des collecteurs tous les ans à la
pluralité des voix. Ils étaient chargés de rédiger les rôles des tailles
(on les appelait alors les collecteurs-asséeurs) puis du recouvrement.
Nous reviendrons sur le principe de cet impôt direct au XVIIIème siècle.
Les collecteurs devaient donc savoir lire et écrire. Ils devaient
être également jugés bons, solvables et capables par la communauté
villageoise. Eux-mêmes taillables, ils étaient responsables sur leurs
biens des deniers amassés. Ils étaient même parfois obligés de faire des
avances sur leurs propres deniers. Ils devaient donc nécessairement avoir
une assise financière personnelle solide.
Pour ce travail, ils se rémunéraient en prélevant une somme plus
élevée sur les contribuables. Cette rémunération était cependant loin de
les dédommager puisque cette charge était risquée financièrement et très
prenante. Ils devaient parfois mettre leur propre activité en suspend
pendant leur fonction.

Cette charge n'était donc pas recherchée. En étaient exemptés les
nobles, les membres du clergé, les septuagénaires, les infirmes, les pères
de 8 enfants mariés, les fabriqueurs, les syndics, les greffiers, archers,
arpenteurs, commis, maîtres d'école, le sacristain, les médecins et
chirurgiens.
À Bournezeau et Saint-Vincent-Fort-du-Lay 16 actes sur 25
concernaient la nomination des collecteurs et des questions liées à
l'imposition. Au début du siècle 6 collecteurs étaient nommés à
Bournezeau, puis un 7ème à partir de 1723 ; seulement 2 à
Saint-Vincent. Pour illustrer la difficulté de nommer un collecteur, une
assemblée fut particulièrement houleuse à Bournezeau en 1724. Voici le
compte-rendu dans sa quasi-intégralité :
« Aujourd’hui dimanche 16ème du mois de janvier 1724 en
l’assemblée des manants et habitants de la paroisse de Creil-Bournezeau
étant sous les halles dudit lieu à l’issue des Vêpres au son de la cloche
en la manière accoutumée, icelle assemblée convoquée par Jean T
L’assemblée a désigné comme 7ème collecteur-asséeur Thomas T
Il n’y a aucune signature sur le procès-verbal à l’exception de
celle du notaire M
Avant 1789, nos deux paroisses étaient rattachées
administrativement à l'élection de Fontenay-le-Comte, dans la généralité
de Poitiers. Le principal impôt direct était la taille dite “personnelle”,
c'est-à-dire qu'elle était prélevée sur le revenu de chaque roturier. Pour
cela, le pouvoir devait faire une enquête annuelle afin d'être informé sur
la situation de chaque contribuable. Ces enquêtes étaient confiées aux
collecteurs-asséeurs. Dans le sud de la France, la taille était dite
“réelle” parce qu'elle était basée sur la propriété foncière,

Cet impôt, créé au XVème siècle, était devenu une des
principales ressources du budget de l'État. Le montant total était fixé
par le roi en son Conseil, ensuite divisé entre les différentes
généralités du royaume, puis partagé entre les élections et enfin entre
les paroisses par le biais des collecteurs-asséeurs. Ces derniers
rédigeaient des tableaux ou rôles sur lesquels était inscrit le nom de
chaque chef de famille et éventuellement le montant que chaque feu (ou
foyer) devait payer.
Une fois les rôles établis et vérifiés par un officier de l'élection, ils
étaient publiés un dimanche à l'issue de la messe, à la porte de l'église.
Ainsi, en cas de désaccord sur le montant de l'impôt, le contribuable
pouvait faire appel.
Dans un dernier temps, les collecteurs se rendaient dans chaque feu
pour prélever les paiements échelonnés théoriquement le 1er jour des mois
de décembre, mars, mai et octobre.
S'ils étaient confrontés à un problème et pour se couvrir, ils
réunissaient une assemblée villageoise qui prenait la décision.
Le 22 janvier 1713, par exemple, les collecteurs de Bournezeau
avaient sollicité l'assemblée pour prendre la décision d'imposer ou non
des métairies et borderies de la paroisse appartenant à des propriétaires
vivant en dehors de la paroisse. « (…) A quoi les habitants ont
tous d'une unanime voix donné plein pouvoir (…) auxdits collecteurs
(…). »
L'assemblée leur avait également promis le remboursement des frais que les collecteurs devaient engager si les métairies étaient réellement exemptées de toute taxe. L'intérêt pour la communauté était qu'un maximum de feux payassent la taille afin d'alléger la charge de chaque contribuable. Bien évidemment la Taille n'était pas le seul impôt de l'Ancien Régime. On peut citer, pour les plus importants, la capitation, le vingtième, les corvées, le cens, la dîme... Notre région n'était pas soumise à la gabelle, l'impôt sur le sel. Grâce à ces quelques actes notariaux, nous avons connaissance d'une réalité politique au XVIIIème siècle : les habitants de Bournezeau et Saint-Vincent-Fort-du-Lay, réunis en assemblée, avaient le pouvoir de choisir leurs représentants locaux qu'étaient les syndics, les fabriqueurs et les collecteurs. Toutefois les assemblées n'étaient pas totalement indépendantes puisqu'elles étaient sous la surveillance à la fois de l'État, des seigneurs locaux et de l'Église.
Les actes notariés nous donnent encore le nom et la fonction d'un certain nombre d'habitants de nos deux paroisses, informations intéressantes pour les généalogistes et les historiens locaux.