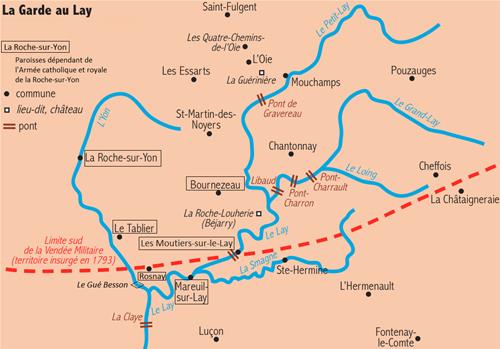
Carte de la zone occupée par les Vendéens au printemps 1793, entre le Lay et l’Yon (fond de carte extraite du site internet “Vendéens et Chouans” et de A.
Garder le Lay pour éviter la pénétration dans le bocage des armées
républicaines, telle est la mission des insurgés vendéens de notre région
en cette fin d’avril 1793. Mareuil-sur-Lay et les Moutiers-sur-le-Lay sont
les deux secteurs les plus menacés.
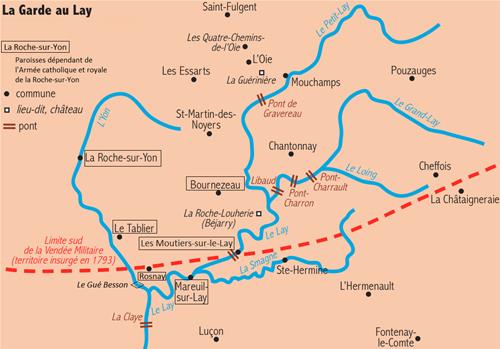
Mareuil-sur-Lay est occupé par les Vendéens depuis le 13 ou 14 avril
1793. Le 16 avril
La menace républicaine autour de Mareuil l’inquiète puisqu’il
ajoute : « On nous assure que plusieurs brigands rôdent sur
les paroisses de Chaillé, le Tablier, Rosnay et qu’ils veulent faire
brûler la maison de M.
Ne pouvant lui-même intervenir de peur d’affaiblir son poste
avancé de Mareuil, il demande à la Roche-sur-Yon d’ordonner un détachement
de soldats d’Aubigny et des Clouzeaux pour patrouiller dans ces trois
paroisses contrôlées en principe par
Peu après, une nouvelle lettre de
Mais le 22 avril, Mareuil-sur-Lay est attaquée par les
Républicains. Le combat a duré plus de trois heures. Dans son compte rendu
fait aux commandants de la Roche-sur-Yon,
Il en profite pour leur demander de la poudre et des munitions
ayant, dit-il, plus de 100 soldats qui n’ont pas un coup à tirer.
Du côté Républicains une lettre du 25 avril 1793 écrite par
C’est que les brigands de Mareuil n’y sont pas plus de 2 à
300, mais qu’il faudrait des forces infiniment supérieures et surtout de
l’artillerie pour les y attaquer ; outre le Lay dont le passage n’est
pas aisé, ils sont retranchés derrière le vieux château et l’église et
toutes les (…) fortifications ; les fossés du vieux château, les
broussailles dont ils sont couverts, les mettent à l’abri de notre feu et
exposeraient la vie de bien des Patriotes si on les attaquait (…) de ce
côté-là (…). Port-la-Claye est bien gardé et cela est nécessaire car
c’est un poste important. Nous trouvâmes tous les postes en activité sur
la route où nous passâmes. Nous ferions des merveilles si nous étions plus
forts. »

La pression républicaine se poursuit encore avec une avancée
victorieuse le 24 avril sur le Champ-Saint-Père.
Pour desserrer l’étau républicain, les Vendéens décident de
s’emparer du pont des Moutiers-sur-le-Lay. L’opération doit être menée le
26 avril 1793 conjointement par l’armée de
Le détachement parti de Bournezeau s’est malgré tout avancé sur les
Moutiers, s’en est rendu maître après un long combat, puis s’est avancé
vers Bessay où il a aperçu des cavaliers ennemis. Faute de munitions le
commandant du détachement, nommé
Les Moutiers restent aux mains de l’armée républicaine mais c’est
une partie à reprendre pour les Vendéens selon les propres termes de
Un nouvel engagement est enclenché ce lundi 29 avril 1793. Un long compte
rendu est envoyé quelques jours plus tard aux commandants de la
Roche-sur-Yon. Il donne des informations intéressantes sur la stratégie
adoptée et l’attitude des soldats vendéens :
« Vous avez su que lundi dernier nous nous sommes rendus
maîtres des Moutiers où ont marché M.
Pendant ce temps-là M.
Nous avons tous restés fort tranquilles jusqu’à 5
heures [du soir] où il s’est élevé un peu d’ennui occasionné par la peur
qu’on avait d’être enveloppé par les troupes de Sainte-Hermine et de Luçon
dont l’ennemi nous avait menacés. Il a fallu bien courir et bien crier
pour retenir nos gens dont quelques-uns étaient déjà partis et dont au
moins les 2/3 m’auraient abandonné si je n’avais pris à près de 7 heures
le parti d’aller à la Corbinière, maison très près des Moutiers par [delà]
le Lay, où nous avons couché ou plutôt où nous avons tous veillé pour être
mieux en garde (…). Mais un moment avant 5 heures [du matin] la cavalerie
et l’infanterie ennemies ont paru sur la route de Sainte-Hermine aux
Moutiers (…) mais beaucoup [de nos hommes] ont de nuit abandonné leur
poste. L’ennemi qui nous croyait aux Moutiers et qui jugeait, sans doute,
qu’il n’y avait qu’un détachement à la Corbinière a tiré un coup de canon
sur les Moutiers. Ce coup et quelques autres ont tellement épouvanté notre
monde qu’il n’est resté que 30 hommes encore en comptant la cavalerie qui
est restée après nous environ un bon quart d’heure (…) L’ennemi approchant
et ceux qui sont restés voulaient se rendre à Mareuil. J’en ai de nuit
pris la route croyant arriver hier à 11 heures du matin. Nos cavaliers ont
quitté la Corbinière quand l’ennemi s’avança sur le pont des Moutiers.
Quand nos soldats ont vu que je prenais le chemin de Mareuil, plusieurs
m’ont rallié en route. Sur les 3 heures du même soir [30 avril] M.
La première garde avait été mise en déroute par nos courriers et s’était
enfuie prévenir aux Moutiers où nos courriers ont aperçu la cavalerie
ennemie sur le pont. Du moment que le détachement a été informé, les 2/3 a
encore fui malgré l’opposition de quelques braves gens. M.

C’est une nouvelle déconvenue pour l’armée de Saint-Pal. Nous
ignorons s’il y a des blessés et des tués. Cependant, si le nombre de
coups de canon n’est pas exagéré, il est probable que des dégâts soient à
déplorer dans le bourg des Moutiers-sur-le-Lay.
Un constat s’impose également : les soldats sont peu
disciplinés, enclins au pillage, peu aguerris et, selon A. B
Autre conséquence de cette défaite : Mareuil-sur-Lay est
grandement menacée par l’armée républicaine basée à Luçon et au
Port-la-Claye. À l’est, les Moutiers-sur-le-Lay est aux mains des Bleus. À
l’ouest le Champ-Saint-Père n’est plus occupé par les Vendéens.
L’offensive républicaine semble donc prévisible en ce début de mai 1793.